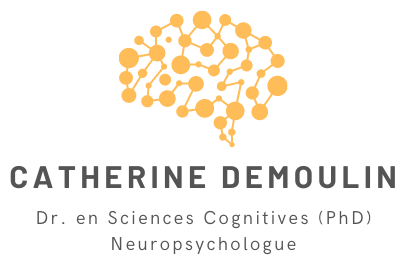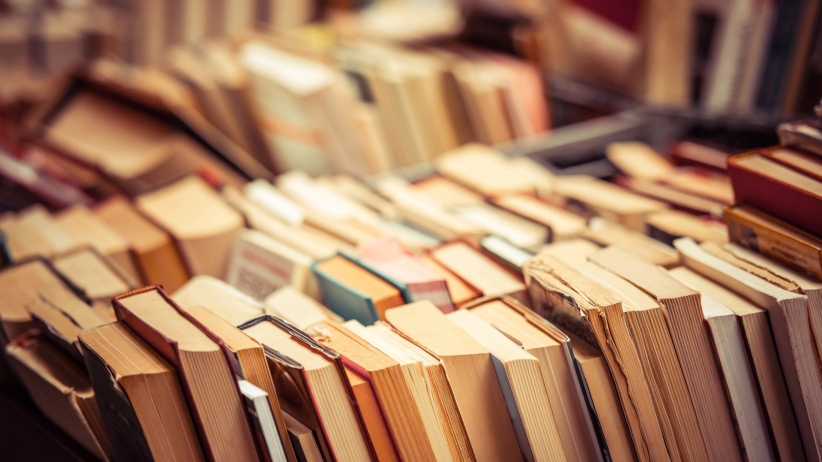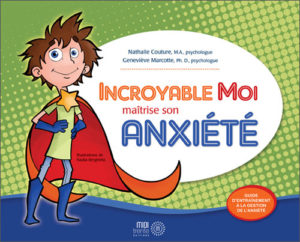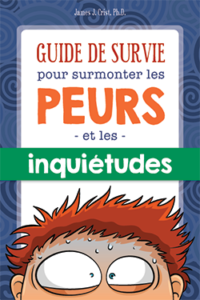Céline (nom d’emprunt), 45 ans, cadre dans une multinationale, me consulte car elle a l’impression d’avoir des problèmes d’attention. Elle suspecte un TDAH car elle se sent aussi très agitée mentalement et hyperactive: elle n’arrive pas « à ne rien faire » ou à profiter d’un bon moment. Elle procrastine aussi parfois dans ses projets professionnels.
Lors du premier entretien, Céline explique qu’elle a beaucoup de mal à se concentrer à son travail, qu’elle ne sent pas efficace et qu’elle doit toujours vérifier son travail pour éviter les erreurs. Quand je lui demande si elle reçoit des remarques ou des évaluations négatives de la part de ses collègues ou de ses supérieurs, elle explique qu’ils ne remarquent rien et sont, au contraire, très satisfaits d’elle. Cela la met encore plus mal à l’aise et elle a l’impression qu’on surestime ses compétences ou se trompe sur son compte. Je remarque dans le discours de Céline beaucoup de craintes par rapport au fait de commettre une erreur dans ses tâches professionnelles ou d ‘échouer. Quand je lui demande si elle commet frequemment des erreurs d’innattention, Céline explique que c’est rare parce qu’elle est perfectionniste. Enfin, quand je lui demande comment elle se sent généralement après un succès et sur ce qu’elle se dit intérieurement, elle répond qu’elle est rarement satisfaite de son travail et qu’elle se dit souvent qu’elle aurait pu mieux faire. Dans sa vie privée, Céline n’a pas beaucoup de loisirs en dehors de sa famille et de son ménage. Elle n’arrive pas à se détendre. Quand elle procrastine une tâche importante, c’est pour faire des tâches professionnelles secondaires, mais jamais pour faire une activité plaisante. Céline explique qu’elle a eu des parents très exigeants. Il fallait ramener d’excellentes notes. Elle était dans une école également exigeante où les élèves étaient fréquemment comparés les uns aux autres selon leurs notes. Elle ressentait beaucoup de pression et de stress. Elle a réussi brillament à l’école et plus tard à l’université mais, selon elle, au prix de beaucoup d’efforts. Elle ne pense pas avoir des facilités sur le plan intellectuel car, d’après elle, si elle en avait, elle ne devrait pas faire autant d’efforts pour réussir. Elle pense aussi avoir eu beaucoup de chance dans la vie car elle vient d’un milieu socio-économique favorisé.
Comme je m’y attendais les quelques épreuves attentionnelles que j’ai fait passer à Céline sont très bien réussies. Malgré ses belles performances, Céline montrait cependant beaucoup d’anxiété et de doute lors de l’évaluation. Son histoire n’est pas non plus compatible avec un TDAH. Mais alors, qu’est-ce qui peut expliquer les difficultés d’attention de Céline?
D’une part, Céline manifeste beaucoup de préoccupations anxieuses, ce qui peut affecter ses capacités attentionnelles et sa mémoire de travail. En outre, elle est très souvent stressée et ne semble pas réussir à se détendre, ce qui peut conduire à un épuisement qui va aussi affecter ses ressources attentionnelles. D’autre part, son discours et son histoire démontrent un décalage très important entre la manière dont elle se perçoit (peu efficace, peu compétente) et la manière dont elle est perçue en réalité par son entourage (très organisée, efficace et intelligente), ce qui fait penser au syndrome de l’imposteur.
Le syndrome de l’imposteur (SI) tel que défini par Pauline Rose Clance, désigne un doute persistant quant à ses compétences et une peur irrationnelle d’être démasqué(e) comme un « fraudeur » malgré des succès objectifs. Les personnes qui en souffrent attribuent souvent leurs réussites à des facteurs externes (chance, circonstances, aide d’autrui) plutôt qu’à leurs compétences réelles. Clance a d’abord observé ce phénomène chez des femmes hautement performantes, mais des recherches ultérieures ont montré qu’il concerne aussi bien les hommes que les femmes et peut toucher divers domaines professionnels et académiques.
Les caractéristiques principales du SI selon Clance :
- Sentiment de fraude malgré des preuves de réussite, impression de tromper les autres
- Peur d’être exposé(e) comme incompétent(e)
- Difficulté à intérioriser, accepter ses succès
- Attribution des réussites à la chance ou à l’aide extérieure.
- Auto-exigence excessive, perfectionnisme
- peur de l’échec et des erreurs
Selon une étude de Bravata et al. (2020), le syndrome de l’imposteur est significativement corrélé à des niveaux élevés d’anxiété. Il est notamment fortement associé à l’anxiété de performance et à l’anxiété généralisée. Les personnes concernées ressentent en effet une pression constante pour maintenir un niveau de réussite élevé par peur d’être « démasquées ». Cette peur peut engendrer :
- Une rumination anxieuse : anticipation excessive de l’échec et scénarios catastrophes.
- Un perfectionnisme rigide : procrastination ou surinvestissement pour éviter toute erreur.
- Des symptômes physiques d’anxiété (palpitations, tensions musculaires, troubles du sommeil).
Lorsque le syndrome de l’imposteur est chronique, il peut évoluer vers une baisse de l’estime de soi, une dévalorisation excessive, un sentiment d’incompétence, épuisement émotionnel qui sont des facteurs de risque majeurs pour la dépression.
le syndrome de l’imposteur et le burnout sont aussi étroitement liés, car les mécanismes psychologiques du premier peuvent favoriser l’épuisement professionnel. Ainsi, un niveau d’auto-exigence excessive conduit à travailler plus que nécessaire pour « prouver sa valeur » ou fournir un travail « parfait ». De même, la difficulté à reconnaître ses réussites mène à un sentiment de ne jamais en faire assez.
Cet hyper-investissement n’est généralement pas compensé par des périodes de repos ou de détente car il y a généralement une sensation de culpabilité lors des pauses. Il n’est donc pas étonnant que les capacités attentionnelles en prennent un coup, elles qui ne sont pas illimitées. En outre, l’anxiété chronique conduit à un stress persistant délétère qui fait le lit du burnout.
Le surinvestissement alterne aussi avec des phases de procrastination : réaliser un travail « parfait » (idéal de la personne) demande énormément d’énergie, de travail et est particulièrement anxiogène. Comme la personne craint d’échouer ou d’être critiquée, elle évite de s’y mettre, se lance frénétiquement dans des tâches plus secondaires (trop stressée pour s’amuser). Quand elle finira par s’y mettre en dernière minute, elle pourra protéger son estime de soi fragile en se disant « Si j’échoue, c’est parce que je n’ai pas assez travaillé, pas parce que je suis incompétente. » Cette stratégie inconsciente de protection peut aussi constituer de l’auto-sabotage : la personne se met elle-même des bâtons dans les roues pour éviter de confronter une peur profonde : l’échec, le rejet, ou la confirmation qu’elle « n’est pas à la hauteur ». Parfois, ça passe et le travail en dernière minute est tout de même bien fait, mais parfois, il est abandonné (« Je préfère ne pas essayer plutôt que de faire quelque chose de moyen. »).
Céline a été rassurée sur ses capacités attentionnelles, mais il lui a donc été vivement conseillé de réaliser un suivi thérapeutique impliquant notamment :
- Une restructuration cognitive : identifier et déconstruire les pensées automatiques négatives (pensées/croyances dysfonctionnelles), apprendre à attribuer ses succès à ses propres mérites quand c’est justifié, etc.
- Un travail sur le discours intérieur et l’auto-compassion : accepter ses réussites sans les minimiser, apprendre à se parler de manière encourageante et constructive, etc.
- L’apprentissage de techniques de gestion du stress : méditation, respiration, TCC, activité physique etc.
- La psychoéducation sur le phénomène pour prendre du recul (lecture d’ouvrages ou écoute de podcasts sur ce thème)
- L’apprentissage de stratégies et conseils neuropsychologiques pour mieux comprendre et prendre soin de ses ressources cognitives et émotionnelles.
Sans cela, elle risque effectivement de s’épuiser et de voir un jour ses capacités cognitives réellement affaiblies. En effet, le stress chronique à long terme est délétère pour les capacités cognitives comme la mémoire et l’attention. Le stress prolongé entraîne une libération excessive de cortisol, qui peut littéralement rétrécir l’hippocampe, une structure clé pour la mémoire. Il perturbe aussi les processus de régulation du cortex préfrontal, essentiel pour l’attention soutenue, le contrôle des impulsions et la flexibilité cognitive. Après un burnout, il arrive aussi que l’amygdale, centre de la peur et des émotions, devienne hyperactive, entraînant un état de vigilance permanent. Ce qui peut expliquer pourquoi beaucoup de patients post-burnout se décrivent ainsi souvent comme beaucoup plus sensibles et émotionnels qu’avant.
Catherine Demoulin
Pour aller plus loin:
Le syndrome de l’imposteur : les clés pour changer d’état d’esprit ! De Kevin Chassangre
Traiter la dépréciation de soi : le syndrome de l’imposteur. De Kevin Chassangre